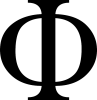Le juste et l'injuste ne sont-ils que des conventions ? publié le 16/07/2010
Lorsqu’elle comparaît devant Créon, son oncle devenu le nouveau maître de Thèbes, pour avoir tenté d’offrir une sépulture à Polynice, son frère déclaré traître à la Cité, Antigone ne songe nullement à nier les faits qu’on lui reproche. Elle reconnaît même être hors-la-loi au regard des règles établies dans la Cité. Mais elle nie, en revanche, être moralement coupable et revendique hautement la légitimité de son geste, se plaçant du même coup au-dessus de la loi des hommes. Créon, de son côté, en jugeant coupable Antigone et en la condamnant à mort, identifie implicitement ses propres décrets à la norme absolue du juste et de l’injuste, et son autorité de tyran au fondement même du droit. Or, le juste et l’injuste ne sont-ils que des conventions ? Ou bien Antigone a-t-elle raison d’invoquer, comme elle le fait, des « lois non écrites , celles-là, mais intangibles », qui ne seraient « ni d’aujourd’hui, ni d’hier, mais en vigueur depuis l’origine, et que personne n’[aurait] vu naître » ? Le problème n’est évidemment pas seulement de savoir si, en fait (c’est-à-dire dans la réalité sociale, politique, historique), le juste et l’injuste ne sont jamais définis et distingués que par convention (simple question de fait : quid facti ?). Il est surtout de savoir s’ils peuvent et doivent l’être en droit, c’est-à-dire par essence ou par principe. Cette question de droit ou de principe (Quid juris ?) est au fond la seule qui nous importe ici, la seule qui soit philosophiquement pertinente. Puisque, en tout état de cause, une notion du juste et de l’injuste fondée sur des conventions ne pourra jamais valoir que ce que valent ces conventions elles-mêmes. Faut-il alors penser le juste selon la loi, ou concevoir la loi selon le Juste ? Et que vaudrait la loi, si elle se réduisait à une simple convention ? N’y a-t-il de lois que positives ? Le juste et l’injuste ne sont-ils donc que des valeurs « d’établissement », selon l’expression de Pascal ? La question nous confronte, semble-t-il, à un dilemme. Peut-on vraiment, à propos du juste et de l’injuste, parler de conventions, d’institutions, de valeurs simplement établies par les hommes, sans tomber dans l’arbitraire ou le relativisme ? Mais, inversement, peut-on parler de « lois non écrites », comme le fait Antigone, sans devoir recourir à une religion, c’est-à-dire à une foi irrationnelle ; ou bien à un savoir certes rationnel, philosophique, mais d’essence métaphysique, avec tout ce que cela peut comporter d’incertain et de risqué, de problématique, voire de chimérique ?
I.
Le juste n’est-il donc qu’une valeur « d’établissement » ? Que penser des conventions comprises comme usages et comme coutumes, comme institutions ? Serait juste ce qui est réputé juste et reçu comme tel au sein des sociétés ; serait injuste ce qui est prohibé par la loi des hommes (i.e. par la loi positive) ou ce qui transgresse les règles établies. Quelles sont les conséquences d’une telle position ? La réponse est immédiate. Cette conception conventionnaliste – partant relativiste – du juste et de l’injuste constitue pour la raison un double scandale : du fait de son illégitimité morale, d’une part ; du fait de son absurdité logique, d’autre part.
Une absence radicale de légitimité, d’abord. Car le règne de la coutume est celui de l’arbitraire et de la contingence, un règne dans lequel la norme du droit est simplement tirée du fait, c’est-à-dire des traditions et des mœurs en vigueur. Un règne où la loi, dépourvue de toute nécessité intrinsèque ou même extrinsèque, suit futilement, comme le déplore Pascal, « les fantaisies et les caprices des Perses et Allemands ». Universellement divers et toujours inconstant, le droit positif « a ses époques ». Qu’on songe, par exemple, que, sous le régime de Vichy, le droit français imputait à crime et punissait de mort la pratique de l’avortement, alors qu’aujourd’hui l’avortement est légalisé et la peine de mort abolie. Le droit positif a donc son histoire – mais aussi sa géographie : un rien, un méridien, un cours d’eau suffit à limiter l’autorité de la loi, changeant ipso facto le juste en injuste et vice versa. « Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au-delà », ironise l’auteur des Pensées. Les conventions humaines ont certes une origine, des sources multiples et même innombrables, mais aucun fondement véritable. Ou plutôt, aucun autre fondement qu’elles-mêmes (la coutume, note Pascal, « est toute ramassée en soi » : elle « fait toute l’équité, par cette seule raison qu’elle est reçue ; c’est le fondement mystique de son autorité. ») – et que leur simple durée. Une durée, on pourrait presque dire une inertie qui, peu à peu, les confirme, les consacre et les rend intangibles, le temps leur conférant après coup la respectabilité d’une tradition immémoriale, reçue depuis toujours ou presque. Faute de quoi, une convention ne pourrait guère valoir plus qu’une simple mode ! Pour un peu, on oserait faire rimer légalité avec frivolité – si l’arbitraire juridique et moral ne se montrait quelquefois si tyrannique et si brutal...
Mais cette relativité rime aussi, et surtout, avec absurdité. Absurdité logique : l’inconstance, la contingence, l’arbitraire, sources d’illégitimité, sont aussi principes d’obscurité, de confusion logique, voire d’auto-contradiction. Car, après tout, le juste de convention est foncièrement paradoxal, et comme une contradiction dans les termes. De fait, prévient laconiquement Pascal, « qui [le] ramènera à son principe, l’anéantit. » Le poser, en effet, comme pure convention, c’est avouer son caractère purement fictif ou factice, et du même coup le nier immédiatement comme juste. Et c’est même le nier tout court. Car les particularismes culturels, les « idiotismes » juridiques et moraux non seulement se juxtaposent, mais ils s’opposent, se contrarient, se combattent, se neutralisent et s’annulent finalement. Leur contradiction est non seulement possible, mais réelle, actuelle, effective, et aussi multiforme, aussi variée, aussi infiniment diverse que le tableau très bigarré des différentes mœurs humaines.
Si le juste et l’injuste ne sont que conventions, autant dire que le Juste n’est pas une valeur ; ou bien que cette valeur n’est qu’illusion, pure chimère ou pure fiction, que la distinction du juste et de l’injuste est au fond impossible et qu’on ne peut point juger selon ces deux catégories. Nous voilà réduits au cynisme moral, voire au nihilisme.
II.
Or, cette valeur « d’établissement », qui ne nous apparaît plus guère que comme une pseudo-valeur, la rendrait-on plus rationnelle – partant moins arbitraire et plus légitime – en la fondant sur une convention utile, en assimilant le juste à l’utile et l’injuste au nuisible ? Ecartons d’emblée le cas de l’utile purement subjectif, personnel, individuel, c’est-à-dire de ce qui, faisant l’objet d’un intérêt particulier, s’identifie plus ou moins au désirable, et qui est donc aussi irrationnel, aussi contingent, aussi singulier qu’une erreur ou qu’un caprice – ou que le « bon plaisir » des monarques absolus. Ce cas, de toute évidence, est réductible au précédent.
Mais rendrait-on les conventions utiles plus rationnelles, et donc plus légitimes, en les fondant sur des contrats (autre acception possible du terme de convention) visant l’intérêt commun des contractants ? Hypothèse séduisante, mais pas totalement convaincante. Car réduire le juste à l’utile, même commun, n’est-ce pas, d’une part, le relativiser selon les intérêts propres des communautés ou des Etats particuliers – c’est-à-dire en nier l’universalité ? A ce compte-là, une société de brigands ou d’assassins pourrait se faire, elle aussi, une notion propre du juste et l’injuste. Et n’est-ce pas, d’autre part, autoriser le sacrifice éventuel des droits de l’individu aux intérêts du groupe ? N’est-ce pas se permettre d’entrer, si nécessaire pour la collectivité, dans la logique du « bouc émissaire » au sens de René Girard ; et se faire, par voie de conséquence, l’apologiste de la Raison d’Etat ? Qu’est-ce donc que la « morale sociale » ? demande Alain : l’ensemble, répond-il, des « mauvaises actions que le Salut Public ou la Raison d’Etat peut nous ordonner d’accomplir ». Or n’est-ce pas, précisément, pour le plus grand bien de Thèbes que Créon croit devoir prendre la grave et pénible décision de sacrifier Antigone ?
L’utilitarisme juridique ne paraît donc pas plus satisfaisant que le positivisme juridique, puisqu’il débouche sur la même inévitable conséquence : le relativisme des valeurs. Le juste, s’il existe, est sans doute plus universel et plus constant que l’utile. Et il est clair que légalité ne rime pas toujours avec légitimité (pensons au Code noir, aux lois de Nuremberg, aux lois de Vichy, etc.) : certains régimes institutionnels ne sont en réalité que des « désordres établis ». Or, si des lois positives peuvent être légitimement dénoncées comme injustes, cette possibilité morale exige d’être fondée. D’où la recherche d’un principe universel et constant, d’une norme intangible et absolue, d’un étalon immuable et véritable du juste et de l’injuste.
III.
Où donc trouver cet étalon ? Peut-on penser le Juste comme un universel objectif et transcendant, c’est-à-dire transcendant à la Cité ? Peut-on fonder la distinction du juste et de l’injuste dans un ordre de valeurs préexistant à la Cité, antérieur et supérieur à la volonté et aux institutions des hommes ? Deux hypothèses sont envisageables : un tel fondement peut être d’ordre naturel, ou bien d’ordre surnaturel – un fondement en nature ou un fondement en Dieu. S’il existe des lois « non écrites », sont-elles des lois divines (des commandements religieux, surnaturels, comme c’est précisément le cas pour Antigone), ou bien des lois naturelles (les principes d’un ordre cosmique objectif et substantiel) ?
Examinons d’abord la thèse d’un fondement théologique de la distinction du juste et de l’injuste, l’idée d’une législation divine. Écartons d’emblée l’hypothèse de la rationalité de cette loi. Si la Loi divine est conçue comme rationnelle, ne se confond-elle pas avec la loi naturelle, c’est-à-dire avec une loi immanente à la nature, quel que soit le concept que l’on se fasse par ailleurs de cette nature ? Mais, inversement, poser des normes transcendantes, divines, surnaturelles, renoncer à la loi naturelle, n’est-ce pas renoncer à la raison, renoncer à comprendre les valeurs ou, pire, renoncer à les connaître ?
De fait, une fondation théologique de la distinction du juste et de l’injuste nous confronte immédiatement à deux difficultés majeures, qui sont d’ailleurs intimement liées : l’une qui tient à l’irrationalité intrinsèque de ce fondement, l’autre qui tient au rapport d’« hétéronomie » absolue qu’il instaure entre la Loi et le sujet qui lui est soumis.
Si l’idée de la Justice découle d’une législation divine et transcendante, comment donc peut-elle être intelligible et accessible à l’homme ? L’homme pourra-t-il la connaître sans l’événement miraculeux de la Révélation ou de la Grâce, événement ô combien ! singulier, exceptionnel, irrationnel, partant imprévisible et incompréhensible ? Pire encore, si Dieu est le fondement de l’autorité de la Loi, et la Foi le fondement de l’Autorité divine aux yeux du fidèle, n’est-il pas clair qu’on tombe dans un cercle logique ? Toute morale révélée s’enferme nécessairement dans ce « cercle de la Foi » : la Loi de Dieu ne vaut que pour autant que nous croyons qu’elle vaut !
Cette première difficulté serait, certes, surmontable si les hommes pouvaient comprendre la Loi divine dans sa nécessité morale intrinsèque, dans son caractère proprement obligatoire. Mais c’est précisément ce qui est impossible. A quel titre, en effet, à quelle condition les Commandements divins peuvent-ils nous apparaître comme des impératifs ? Au titre qu’ils expriment la volonté du Très-Haut, c’est-à-dire au prix, semble-t-il, d’une aggravation absolue du rapport d’« hétéronomie ». Car la volonté du Très-Haut, c’est d’abord la volonté d’un autre – et même d’un Tout-Autre ! C’est là l’autre rançon de la transcendance de la Loi : toute « théonomie » est hétéro-nomie. L’homme, incapable d’entrer dans le dessein de Dieu et toujours assujetti de l’extérieur à sa Loi, est forcément inapte à saisir le principe interne de l’autorité et de la légitimité de cette Loi, impuissant à discerner les raisons de la Loi. Du coup, le caractère proprement respectable, impérieux, obligatoire des Commandements lui échappe. La Loi n’est plus perçue qu’irrationnellement, comme l’expression de l’Arbitraire divin, comme l’« oukase » ou le « diktat » de la Volonté suprême, c’est-à-dire comme une contrainte morale absolue, adossée à la menace permanente d’un terrible châtiment par la Toute-Puissance. Ainsi, pour la pieuse Antigone, violer les « lois non écrites » conçues comme lois divines, c’est avant tout, dit-elle, « par un lâche respect pour l’autorité d’un homme, encourir la rigueur des dieux ». Pensons aussi, et surtout, au Décalogue ou à la loi du Talion – lois certes « écrites », celles-là, ou plutôt inspirées par Dieu, mais pas écrites par les hommes, pas même par Moïse. Nécessairement assortis de la menace du châtiment, ces Commandements d’un « Dieu jaloux […] poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois à quatre générations » (comme dit le texte du Décalogue), ces Commandements sont-ils autre chose pour le fidèle qu’une liste d’« impératifs hypothétiques », se résumant au principe suivant : « Si tu crois en Moi et que tu ne veuilles pas subir Mes foudres, alors obéis-Moi ! » ?
IV.
Envisageons maintenant l’autre partie de l’alternative : la « loi non écrite » conçue comme loi naturelle. Que faut-il entendre par là ? Cette loi naturelle est-elle une loi de la nature ? Répondre à cette question par l’affirmative, c’est adopter une position qu’on peut qualifier de naturaliste. Or qu’est-ce que ce naturalisme ? C’est une forme de réalisme, c’est-à-dire une réduction du Juste à l’ordre effectif et actuel du Cosmos, donc une réduction de l’Idéal au Réel, et de la Valeur au Fait. C’est ce qu’on pourrait appeler une « cosmonomie » physique. Or connaître le réel, même objectivement, ce n’est pas encore être en mesure de le juger. L’idée de l’être, que nous dit-elle sur le devoir-être ? Le naturalisme compris à la façon de Calliclès est même le comble du cynisme et de l’amoralisme : il se réduit en fait à la loi du plus fort. Pour Calliclès, les lois égalitaires ne sont que des conventions arbitraires, des artifices contre-nature, partant injustes et absurdes. Le droit naturel, pour lui, c’est l’a-nomie, l’absence de règle. Or, s’il en était ainsi, « le loup raisonneur de la fable » (pour reprendre l’expression d’Alain), qu’aurait-il donc besoin de raisonner pour se justifier, en invoquant toujours de mauvaises raisons ? Il lui suffirait d’être ce qu’il est, c’est-à-dire puissance, et de demeurer ce qu’il est, de persévérer simplement dans sa puissance, pour être toujours dans son bon droit.
Cette doctrine, on le voit, n’est donc pas seulement immorale, partant illégitime. C’est aussi une conception « physique » – conception soit mécaniste, soit fataliste – de l’hétéronomie morale, qui, de toute évidence, confine à l’absurdité. Car enfin, nécessité peut-elle raisonnablement faire loi, au sens juridique ou moral du terme de loi ? Est-ce par sentiment d’obligation que j’obéis aux lois de la pesanteur ? Notre sens de la Justice se réduit-il à l’amor fati ? La réponse va de soi. En outre, si le Juste existait naturellement, et donc effectivement et objectivement, par une nécessité mécanique ou fatale, alors tout ce qui existe ne serait-il pas forcément juste ? La Cité des hommes elle-même pourrait-elle déroger aux lois de l’Univers ? Pourrait-elle être « comme un empire dans un empire » ? Si non, alors toute règle, toute autorité, toute institution ne sera-t-elle pas forcément légitime, du moment qu’elle existe ? Et si le plus grand nombre fait régner sa loi, comment Calliclès pourra-t-il, en vertu de sa propre doctrine, être encore fondé à s’en plaindre ? Enfin, si tout ce qui est effectivement est aussi juste par principe, on ne pourra même plus envisager la moindre possibilité d’enfreindre la « loi naturelle », ni en droit ni en fait, comme Rousseau le souligne ironiquement dans une célèbre page du Contrat social : « Obéissez aux puissances. Si cela veut dire, cédez à la force, le précepte est bon, mais superflu, je réponds qu’il ne sera jamais violé. » En assimilant ainsi l’être au devoir-être, et en niant la liberté, n’est-il pas clair qu’on rend du même coup l’injustice impossible ?
Il semble bien qu’on ne puisse pas sauver les valeurs, si on les réduit simplement aux phénomènes ou même aux « lois » – si mal nommées pour le coup – qui régissent ces phénomènes. Certes, on pourrait encore espérer préserver cette belle idée (très ancienne et très classique) de la Nature conçue comme norme absolue du Juste, et la tirer de la double ornière du cynisme et de l’absurdité. Il faudrait pour cela « sauver les phénomènes » en quelque sorte ; en ce sens qu’il faudrait voir dans la Nature un modèle de perfection, d’ordre et de beauté, dont la loi immanente et intangible prescrirait aux hommes la norme à suivre et la fin à poursuivre dans leurs propres actions. Bref, il faudrait renverser le mécanisme en finalisme, et considérer non plus le Réel comme idéal, mais l’Idéal comme réel ou comme réalisé. Mais cette conception idéalisante de la Nature comme Ordre téléologique, cette « cosmonomie » morale n’est-elle pas une forme de providentialisme sans Dieu, dont la rationalité trouve finalement assez vite ses limites ? Peut-elle seulement se développer de façon autonome, sans devoir se prolonger ou se convertir en théologie ? Peut-elle asseoir la valeur morale de l’Ordre universel sans tomber à son tour, en tant que « cosmodicée » si l’on ose dire, dans les arguties et les apories traditionnellement inhérentes à la théodicée ? Il est évident que non.
Néanmoins, ne peut-on pas sauver autrement les valeurs, en opérant un dépassement du simple naturalisme par le recours à un réalisme transcendant, c’est-à-dire métaphysique ? C’est la solution platonicienne, qui sépare radicalement l’Idéal du fait sensible. Mais, quand l’Idée du bien, c’est-à-dire le Bien en soi, serait située au-delà de la Nature (et même, selon une formule aussi célèbre qu’énigmatique, « au-delà de l’essence ») ; quand cette Idée du Bien serait donc métaphysique, éternelle et immuable, elle ne cesserait point d’être au principe de l’Être, comme ce qui fait être l’être – c’est-à-dire le réel – même si c’est plus à titre de cause finale que de cause efficiente. Elle serait le Principe des principes, le Paradigme absolu, bref le principe ontologique par excellence, susceptible comme tel de faire l’objet d’une connaissance métaphysique, c’est-à-dire d’une science au sens platonicien. Ainsi Socrate pourra-t-il reprocher à Calliclès de faire l’apologie de l’injustice pour la simple raison qu’il néglige la géométrie, s’empêchant du même coup d’apercevoir l’ordre de l’Être – ou plutôt l’être comme Ordre. Mais on voit aussi qu’il n’y a rien là qui puisse nous satisfaire. Car il est clair que toute science, quelle qu’elle soit, ne parle qu’à l’indicatif, et jamais à l’impératif. Le discours de la science est toujours simplement descriptif, jamais prescriptif. N’en déplaise à Spinoza, la Physique n’est pas une Ethique – et la Métaphysique non plus, n’en déplaise à Platon. L’Être n’est pas le Devoir-être. Le Vrai n’est pas encore le Bien.
V.
Si donc elle est de l’ordre de l’idéal, et non du réel, alors la justice n’« existe » pas. Et c’est pourquoi « il faut la faire », note pertinemment Alain : « La justice n’existe point ; [elle] appartient à l’ordre des choses qu’il faut faire justement parce qu’elles ne sont point. […] Je me garderai, insistera-t-il encore, dans ses Éléments de philosophie, de considérer jamais la justice comme quelque chose d’existant qu’il faut accepter ; car la justice est une chose qu’il faut faire et refaire […] ».
La distinction du juste et de l’injuste, si elle est possible, et ce droit qu’on dit « naturel », s’il est pensable, ne peuvent donc pas être tenus pour objectifs et substantiels. Et c’est pourquoi ils ne sauraient, comme on l’a vu, relever d’une science. Dans ces conditions, il ne nous reste plus qu’à les chercher dans la nature même de l’Homme, en cherchant ce qu’il peut y avoir d’universel dans la volonté humaine. Mais peut-on le faire sans retomber dans une anthropologie scientifique et objective, dans une métaphysique essentialiste ou dans un substantialisme religieux ?
En fait, des conséquences capitales peuvent être tirées d’une définition très simple de la nature humaine. Tenons-nous en à une définition aussi minimaliste que possible, dénuée de tout présupposé métaphysique ou religieux, mais qui soit tout simplement présupposée par notre sujet lui-même : l’homme est cet animal qui est capable de poser des conventions et d’y obéir, à tort ou à raison. C’est un fait indéniable : s’il existe des conventions, c’est bien que l’homme est capable d’en créer. Et cette capacité, qui trace pour certains la ligne de partage entre nature et culture, est universellement présente en nous. C’est donc une définition de l’humanité comme auto-nome, c’est-à-dire comme législatrice en général, comme universellement capable de légiférer et d’établir des conventions, bref de s’imposer à elle-même (autos) des règles (nomoï), fût-ce arbitrairement, fût-ce déraisonnablement, fût-ce par pur caprice ou pure fantaisie ; éventualité que, rappelons-le au passage, Montesquieu choisit précisément d’écarter dans L’Esprit des lois : « […] j’ai cru que, dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, [les hommes] n’étaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies […] La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la Terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine. » Et il faut bien avouer qu’une faculté législatrice en l’homme a nécessairement quelque chose à voir avec ce qu’on appellera, après Kant, une « raison pratique ».
Que peut-on donc déduire de cette définition de l’humanité comme législatrice en général ? La simple prise en compte de la faculté législatrice de l’humanité en général implique, semble-t-il, des conséquences théoriques majeures du point de vue d’une philosophie universelle du droit. Ne permet-elle pas, en effet, de définir certains principes transcendantaux – ou, si l’on préfère, structuraux – de justice, principes antérieurs à toute loi instituée et même à tout contrat social fondateur ? Donc, une sorte de « loi naturelle », si l’on veut, mais conçue cette fois comme inscrite dans l’humanité, conçue comme immanente à la nature même de l’homme : bref, une loi « connaturelle » à l’homme, cet être de culture, cet être paradoxal dont la « nature » consiste précisément à ne pas avoir de nature, cet être capable de se définir lui-même en s’éduquant, et dont la conduite n’est jamais simplement déterminée ni régie par la Nature, où il n’a d’ailleurs nulle part sa place marquée. Une telle « loi » impliquerait nécessairement :
1) la reconnaissance et donc le respect de la liberté, c’est-à-dire de la capacité d’autonomie présente en tout homme ;
2) la reconnaissance et donc le respect de l’égalité des hommes dans cette capacité, qui serait fondement a priori d’un principe d’isonomie, c’est-à-dire d’une égalité devant la loi à faire et pas seulement devant la loi faite.
Deux principes cardinaux et structuraux qu’on peut aussi bien qualifier de « droits subjectifs » de la personne, de « droits naturels de l’Homme » et/ou « de l’Humanité », et qui suffisent, à eux seuls, à réfuter la thèse d’une inégalité naturelle (raciale ou autre) parmi les hommes et à ruiner, notamment, la théorie d’un esclavage fondé en nature. Il y aurait place ici, nous semble-t-il, pour une véritable « déduction transcendantale » des droits universels de l’Humanité, c’est-à-dire des principes a priori d’un « Droit naturel », dont la présence et l’activité d’une faculté législatrice « dans des êtres qui reconnaissent [une] loi comme obligatoire pour eux » (Kant) prouvent non seulement la possibilité, mais aussi la réalité objective. Comment, en effet, ne pas voir dans les Droits de l’Homme des principes structuraux ou transcendantaux, aussi nécessaires qu’incontestables en tant que conditions universelles a priori de la capacité effective de tout homme à se donner des lois ?
Certes, le contenu de tels principes (celui d’isonomie, par exemple, sans doute constitutif de toute société démocratique et, plus généralement, de toute définition du Juste) reste encore vague et indéterminé à ce niveau de la réflexion. Mais, de toute évidence, ces principes, loin de pouvoir résulter simplement d’une convention ou d’un contrat arbitraire, constituent au contraire les conditions universelles de possibilité, les conditions a priori de tout contrat légitime possible – puisque, en tout état de cause, un contrat valide et digne de ce nom ne saurait être passé qu’entre des sujets d’abord reconnus comme libres et égaux.
VI.
Il est temps maintenant de tirer certaines conséquences capitales de notre critique préalable du relativisme moral et du positivisme juridique. Si le juste ne peut se réduire au légal, ni l’injuste à l’illégal, s’il est des lois injustes et des infractions légitimes (Antigone), alors il est clair que la notion de justice excède nécessairement l’autorité de la loi, comme l’atteste d’ailleurs la pratique du jugement équitable dans les tribunaux. Et cela, même lorsque la loi n’est pas scélérate, même lorsqu’elle est légitime, raisonnable, incontestable ; mais toujours générale, trop générale, Aristote l’a bien vu, pour être adéquate à la diversité des actions et des choix possibles à l’homme en tant qu’être libre. La justice, comme l’injustice, est sans doute moins dans la loi elle-même que dans le jugement : c’est donc une qualité afférente au jugement. Comment un juge pourrait-il, en fonction de cas toujours particuliers, corriger ou pondérer la justice légale (justice strictement conforme à la lettre de la loi), s’il ne remontait pas en conscience jusqu’à l’esprit de la loi, jusqu’à une loi « non écrite », jusqu’à un pur Idéal de justice ? Un Idéal sensible au cœur, ou bien à la raison ? pourrait-on alors se demander – question que nous soulevons sans pouvoir l’assumer complètement ici. Sera-t-on plus explicite en disant qu’il constitue l’objet par excellence d’une « prudence » prise au sens aristotélicien ? Il est clair, en tout cas, que le jugement équitable n’est pas l’application au particulier d’un universel préalablement connu. Le jugement de valeur qu’il implique n’est pas et ne peut pas être un simple jugement de reconnaissance : nous sommes donc en présence d’un jugement « réfléchissant », au sens kantien du terme.
Or, même si le juge doit nécessairement juger par lui-même « en son âme et conscience », il ne juge pas seulement pour lui-même. Il doit pouvoir pratiquer la « pensée élargie » au sens de Kant, c’est-à-dire se montrer capable de juger en se mettant à la place de tout autre. Il doit pouvoir s’élever au-dessus des conditions subjectives du jugement (conditions sociologiques, psychologiques, idéologiques, etc.) et pouvoir réfléchir sur la valeur de son propre jugement à partir d’un point de vue universel – point de vue qu’il ne peut assurément déterminer qu’en partant du point de vue d’autrui. C’est cette aptitude singulière, cette qualité subtile ou cet esprit de finesse, qu’on appelle proprement l’équité. En suppléant le législateur, en se substituant à lui, l’arbitre ne peut pas se montrer arbitraire. En son « for intérieur » (comme dit si bien la langue), il doit juger pour tous les hommes, et donc aussi par tous les hommes, dans la mesure où sa délibération intime doit toujours pouvoir prendre des accents d’universalité. Soulignons au passage que cette aptitude ne semble pas tant relever d’un don, d’un talent ou d’une vertu exceptionnels, que d’une sorte de « sens commun éthique », chose du monde la mieux partagée, comme le présuppose en droit et le montre assez en fait la pratique de la justice démocratique, qui ne craint pas d’accorder un rôle prépondérant, dans le cadre d’une cour d’assises, aux membres d’un jury populaire.
Voilà pourquoi il nous semble permis de généraliser les conclusions que nous avons tirées d’une analyse de la pratique judiciaire équitable et légitime. « Faire » la justice, selon le mot d’Alain, c’est non seulement la rendre et la faire respecter en faisant appliquer la loi, mais aussi et surtout la concevoir et la définir par nos propres moyens raisonnables – dans l’absence ou le silence même de la loi. Or il est nécessairement un point sur lequel la meilleure des lois se tait toujours : elle ne donne jamais elle-même la règle de sa propre interprétation ni de sa propre application (d’où, notons-le au passage, l’importance accordée à la jurisprudence, conçue elle-même comme source de droit). Devant toute justice concrète s’ouvre nécessairement l’abîme de ce vide juridique. Il faut donc toujours juger.
On comprend désormais clairement pourquoi le Juste n’est et ne peut rien être en soi. C’est qu’il doit d’abord et avant tout l’être pour nous. C’est qu’il est toujours à l’horizon d’un consensus universel possible : un consensus universel simplement postulé, attendu ou recherché à travers le débat et la confrontation publique des idées, et dans lequel on pourrait être tenté de reconnaître la « fraternité » invoquée par la devise républicaine ; fraternité non pas ethnique mais morale, et conçue sur le mode simplement problématique, comme un idéal inaccessible et purement régulateur. Que la Justice absolue nous soit insaisissable n’invalide donc en rien cette exigence d’universalité dont nous sommes porteurs, exigence qui dépasse nécessairement tout système juridique positif. Du point de vue de la réflexion ou de la prudence – celle du juge, mais aussi bien celle de chacun d’entre nous – , le juste comme valeur est seulement l’universalisable, et non un universel donné et connu a priori qu’il suffirait d’appliquer mécaniquement au particulier. Par où l’on voit que la prudence ou l’entendement réfléchissant n’est pas réductible à une simple faculté de penser des exceptions, les exceptions à une règle de justice déjà connue, déterminée ou instaurée. Elle est en effet beaucoup plus que cela : elle est la faculté de statuer sur ce qui pourrait mériter, aux yeux de l’entendement commun, l’appellation de « loi naturelle ». Et cette faculté, il n’est pas un seul jugement équitable, pas un seul jugement authentique et véritable qui ne la mobilise et ne la mette en œuvre. Montaigne, alors même qu’il estimait (en bon sceptique) la chose tout à fait introuvable et impossible, avouait néanmoins, dans son Apologie de Raymond Sebond, que « c’est la seule enseigne vraisemblable, par laquelle [les hommes] puissent argumenter aucunes lois naturelles, que l’université de l’approbation. Car ce que nature nous aurait véritablement ordonné, nous l’ensuivrions sans doute d’un commun consentement. » Un « commun consentement » auquel on pourrait sans doute aussi bien donner le nom de « convention », mais en un sens évidemment supérieur cette fois – un sens plus rationnel et plus universel. Assurément, nous tenons là notre critère universel du juste et de l’injuste.
VII.
De telles prémisses, certaines conséquences d’ordre politique peuvent être immédiatement tirées, et notamment une justification du régime démocratique. Il est clair, en effet, qu’à l’idée du Bien commun ne pourra jamais être adéquate la volonté d’un seul homme, fût-il exceptionnel. Sauf à confondre abusivement sa personne avec le corps politique entier et à prétendre : « L’État, c’est Lui. » Or cette idée du Bien commun conçu comme fin suprême de la Cité, cette idée peut-elle donc être donnée, c’est-à-dire connue a priori, antérieurement à toute délibération ou réflexion des citoyens ? Surplombe-t-elle la Cité terrestre comme le soleil du Bien brillant à l’extérieur de la Caverne de Platon ? Il est évident que non. Le Bien commun, conçu comme Intérêt général, ne peut être défini que par une Volonté générale, à laquelle il ne peut être ni imposé ni superposé, à laquelle il ne peut être ni antérieur ni supérieur.
Une loi juste ne pourra donc jamais être que l’expression directe de la Volonté générale. Cela dit, la conception et la définition de l’Intérêt général par la Volonté générale ne sauraient être totalement factices ni arbitraires. Il est évident, au contraire, que l’autonomie de la Volonté générale porte en elle un principe régulateur interne, une règle immanente qui, telle une boussole, l’empêche d’errer sur l’océan de la Souveraineté. Car, pour être juste et légitime, la Volonté générale ne doit pas aller à l’encontre des valeurs fondamentales ou des principes a priori (à savoir la dignité morale, la liberté, l’égalité « naturelle » des individus) qui la rendent possible et la légitiment en rendant possible et valide le « contrat originaire », le « pacte social » fondateur, la « première convention » qui la fait naître en principe. Rousseau lui-même, dans la sixième de ses Lettres écrites de la Montagne, le souligne avec limpidité, prévenant du même coup l’objection d’un éventuel arbitraire de la Volonté générale : « […] par cette condition de la liberté, qui en renferme d’autres, toutes sortes d’engagements ne sont pas valides, même devant les tribunaux humains. […] Car il n’est pas plus permis d’enfreindre les lois naturelles par le contrat social, qu’il n’est permis d’enfreindre les lois positives par les contrats des particuliers ; et ce n’est que par ces lois mêmes qu’existe la liberté qui donne force à l’engagement. » Il n’est donc pas à craindre que la Volonté générale puisse accoucher du cannibalisme, du Goulag ou de la Shoah. En droit, elle ne saurait être ce « ventre fécond » d’où sortirait « la Bête immonde » ; et l’on peut constater qu’elle ne l’a jamais été en fait. Par où l’on voit que la Démocratie ou, si l’on préfère, la République n’est un régime juste et légitime que pour autant qu’il est celui où la loi – et non simplement le pouvoir – est perpétuellement jugée.
La définition du Juste est donc bien, pour des sujets raisonnables, une tâche infinie, sans cesse recommencée. La Justice n’est pas l’objet d’une science, d’une connaissance objective, mais l’objet d’un perpétuel souci – et d’un débat toujours ouvert entre les hommes. Sans doute est-ce la raison pour laquelle ce que Camus appelle le « Cogito de la révolte » – ce Cogito dont l’évidence n’est jamais saisie que face à l’injustice – est nécessairement pluriel : « Je me révolte, donc nous sommes. » Peut-être est-ce aussi la raison pour laquelle le sentiment d’injustice et la révolte contre l’injustice semblent primer, curieusement, la claire conception du Juste. Car le juste et l’injuste, dans leur opposition même, ne paraissent pas totalement symétriques. « Encore qu’on ne puisse assigner le juste, on voit bien ce qui ne l’est pas », fait remarquer Pascal, avec une grande pénétration. Nous savons reconnaître l’injustice quand elle est là, même si nous ne savons guère ce que pourrait être une justice idéale et parfaite. Car celle-ci n’est jamais que l’objet idéal d’un jugement toujours réfléchissant, d’une discussion permanente entre les esprits raisonnables, d’une délibération toujours actuelle au sein même de la Raison pratique, fût-elle purement intime au sujet comme un « dialogue intérieur de l’âme avec elle-même », selon l’expression platonicienne. Mais celle-là (c’est-à-dire l’injustice) est plus immédiatement reconnaissable, dès qu’elle contredit radicalement les principes « structuraux » de la nature humaine : dignité de la personne, autonomie ou liberté, isonomie ou égalité, etc..
Il nous est maintenant permis de conclure. Si la distinction du juste et de l’injuste n’est pas inscrite dans l’ordre objectif de la Nature ou de l’Être, si elle ne peut pas être lue dans « le ciel étoilé au-dessus de moi », ni contemplée dans le Cosmos intelligible des Essences, c’est qu’il s’agit d’un universel intersubjectif. Un universel dont chacun d’entre nous est, en un sens et pour sa part, porteur en même temps que responsable devant tous les autres. Le juste et l’injuste sont donc tout à la fois des conventions – en tant qu’objets d’un consensus universel possible – et des règles « non écrites ». Ainsi peut-on faire de l’homme la « mesure de toutes choses » en matière de justice et d’injustice, sans pour autant tomber dans le positivisme et le relativisme, sans pour autant tomber dans l’arbitraire. On sait maintenant en quoi et pourquoi l’héroïne de Sophocle est fondée à récuser le jugement de Créon. Car c’est le point de vue d’Antigone, pour peu qu’on le débarrasse de ses présupposés culturels et de ses accents religieux ou affectifs, qui est finalement le plus universel, le plus proche de l’humanité raisonnable. A Créon affirmant : « Tu es la seule, à Thèbes, à professer de telles opinions », elle répond avec une grande lucidité : « Tous ceux qui m’entendent oseraient m’approuver, si la crainte ne leur fermait la bouche. » Et désignant le chœur – qui symbolise toujours la conscience collective de la Cité dans la tragédie grecque – elle ajoute : « Ils pensent comme moi, mais ils se mordent les lèvres. » Face au tyran qui la condamne à mort pour avoir préféré son frère à la Cité, elle pressent qu’elle pourrait partager son intime conviction avec l’humanité entière. Elle aperçoit l’idéal d’une fraternité plus haute. Et Créon lui-même, bien malgré lui pourtant, et pour son propre malheur, Créon le maître absolu de Thèbes devra finalement l’admettre1.
La Rochelle, janvier 2006
Frank Renauld, professeur de philosophie au Lycée Saint-Exupéry
(1) Créon : - « Hélas ! je me dédis, non sans peine, mais il le faut. […] Ainsi, je me suis déjugé. Cette jeune fille que j’ai mise aux fers, je vais la délivrer moi-même. Le mieux, je le crains fort, est de respecter, jusqu’à la fin de ses jours, les lois fondamentales. » (Sophocle, Antigone, Cinquième épisode).